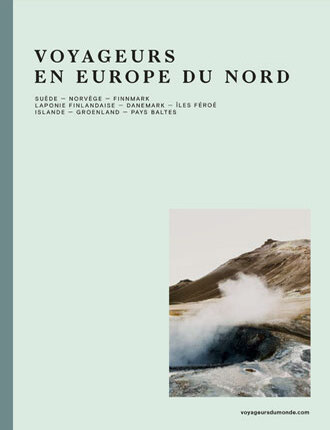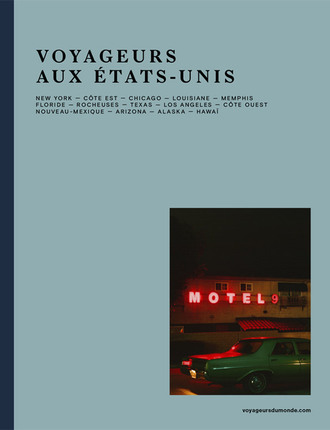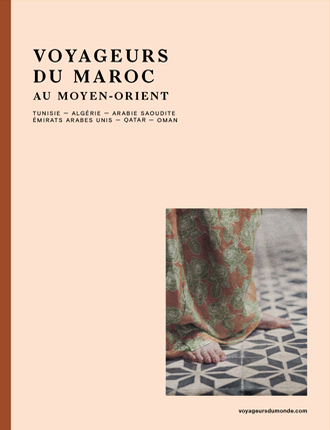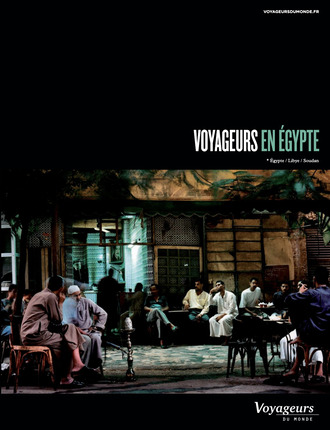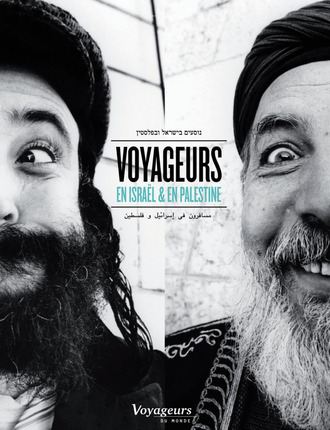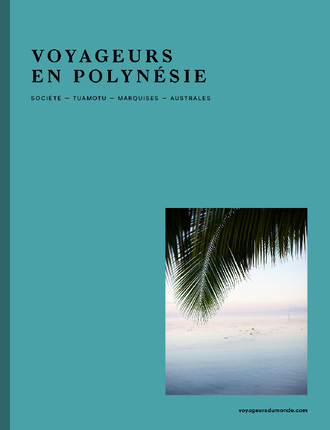S’intéresser au monde, envoyer promener ses idées, débattre des grandes questions d’actualité : tel est l’objet de ce rendez-vous sans prétention pour lequel Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde, reçoit à chaque numéro du Magazine Vacance un invité. Rencontre avec l’essayiste Raphaël Glucksmann.
En cette année d’élections présidentielles en France, Vacance reçoit l’intellectuel Raphaël Glucksmann, militant des droits de l’homme et fervent défenseur de l’ouverture au monde face aux promoteurs du repli sur soi. Voix claire, regard lumineux, celui qui vient de publier Notre France : dire et aimer ce que nous sommes aux éditions Allary analyse les raisons et les enjeux de la situation du pays.

Jean-François Rial : Que pensez-vous du débat actuel entre des agitateurs comme Éric Zemmour et des intellectuels comme vous-même ? En comparaison, celui qui opposait, à l’après-guerre, Jean-Paul Sartre à Raymond Aron ne semblait pas présenter un désaccord aussi profond, pourquoi ?
Raphaël Glucksmann : Nous sommes ici chez Voyageurs du Monde, c’est justement cette ouverture sur les autres qui est remise en cause. Entre les deux intellectuels de bords opposés que vous évoquez – l’un très à gauche, l’autre très conservateur – il existait malgré tout une base commune, une forme de fidélité aux idées héritées de la Révolution française et de l’histoire de France. Les deux hommes s’accordaient sur le fait que les contre-révolutionnaires et la xénophobie avaient perdu, tous deux s’intéressaient au monde, aux droits de l’homme, à la construction européenne, à une France ouverte. Leur débat était très violent mais finalement ils parlaient la même langue, celle de la France humaniste et universaliste. Ils se sont d’ailleurs réconciliés en 1979 sur un point : l’accueil des boat people qui mouraient en mer de Chine. Si l’on regarde à l’heure actuelle la réaction des intellectuels de droite sur la crise des réfugiés syriens, il semble que cette base commune n’existe plus, et très honnêtement Éric Zemmour n’est pas Aron.
J.-F. R. : La cause en est-elle le manque de réponse intellectuelle de haut niveau telle que vous l’incarnez, ou plutôt une problématique de mise en lumière dans un univers médiatique qui donne la parole au spectaculaire ?
R. G. : Aujourd’hui, si ce discours de fermeture fait le buzz, c’est parce qu’il imprime plus les esprits. En osant leur vision du monde, les contre-révolutionnaires orientent le débat. Certes, la France humaniste existe toujours en nombre mais les intellectuels de gauche sont dans l’incapacité de formuler leur discours. Défendre les droits de l’homme est devenu une insulte : “droit-de-l’hommiste”. Les intellectuels et politiques de gauche n’assument pas leur position par peur d’être stigmatisés comme étant déconnectés de la réalité. À l’ère des réseaux sociaux, il n’y a plus de parole établie. Ceux qui gagnent sont ceux qui ne se sentent pas empêchés dans leur propre expression. Les gens qui sont pour une France ouverte sur le monde, qui ne pensent pas que l’autre est dangereux sont à l’inverse plus peureux dans leur expression. Pourtant, l’histoire est de leur côté ! Le destin de la France est lié aux idées qui ont produit l’ouverture sur le monde. Cela est tout de même paradoxal de dédiaboliser Marine Le Pen et d’ostraciser les gens qui viennent en aide aux migrants. Ce n’est pas une tare d’aider les autres !
J.-F. R. : Comment analysez-vous cette incapacité des humanistes à formuler clairement leur position ?
R. G. : Cela est lié à une histoire interne de la gauche, qui a voulu s’émanciper du mythe du surmoi marxiste-léniniste en déconstruisant le récit mythique qui fondait la gauche française. Comme à l’époque elle dominait intellectuellement la France, la gauche s’est dispensée de proposer une nouvelle vision du monde. Un vide conceptuel qui, aujourd’hui, face à une vision réactionnaire très claire, laisse l’idéologie humaniste s’enfoncer dans le laisser-faire. Arrêtons d’avoir peur et assumons nos idées ! Aimer la France d’un amour fou et être mondialiste n’est pas contradictoire. L’enjeu immédiat est pourtant clair : voulons-nous une France ouverte vers le monde ou un pays replié sur lui-même ? Or, à ce jour, la gauche n’affirme pas clairement sa position et le clan du repli a pris une avance considérable. Nous avons perdu cette force de conviction qui permet de rester ferme face aux penseurs contre-révolutionnaires.
J.-F. R. : Ne faut-il pas prendre en compte dans ce combat l’importance des réseaux sociaux – où l’outrance domine la nuance – que vos adversaires maîtrisent par ailleurs très bien ?
R. G. : C’est effectivement là qu’a lieu le combat, en marge des médias officiels. Les réseaux sociaux sont de formidables outils qui ont permis les “révolutions de couleur” et celles des pays arabes, cassant au passage le monopole de l’information. Il faut d’abord arriver à se mobiliser, savoir s’exprimer de manière claire et ferme. Il faut aussi apprendre de nos adversaires. Pourquoi a-t-on cette impression de domination des forces réactionnaires et xénophobes sur les réseaux ? Simplement parce qu’ils agissent en meute. Ils ont eu l’habitude d’être une forme de contre-culture et de se structurer. Ainsi, lorsque je me fais insulter sur Twitter par un extrémiste, il est suivi par 300 autres dans la seconde, ce qui donne une impression de masse. Il va falloir s’organiser pour réagir de manière collective, former des mouvements capables de porter la contradiction de manière non isolée. Ne laissons pas la “fachosphère” prendre le monopole des outils de l’avenir. C’est quelque chose de difficile à intégrer pour les gens qui ont une pensée complexe et qui sont réticents à résumer leur discours en deux lignes, mais c’est obligatoire si l’on veut que celui-ci soit entendu.
J.-F. R. : Comment des gens a priori cultivés peuvent-ils avoir un discours aussi violent, afficher une telle fermeture ?
R. G. : Cette violence de la rhétorique et des concepts prouve que la pensée contre-révolutionnaire, celle qui nie les droits de l’homme et s’oppose de manière violente aux principes de la République française, est revenue. Le plus grave, c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’un débat intellectuel. Comme le soulignait le marxiste italien Antonio Gramsci, l’atmosphère culturelle d’une société défi nit à terme les résultats politiques, et donc ce qui dirige l’hégémonie culturelle d’un pays fi nit par contrôler l’État. Si le débat est si violent, si la remise en cause des principes communs est si profonde, cela va se traduire politiquement. Et nous le verrons certainement très prochainement. Par ailleurs, vous avez sans doute un respect trop grand pour la culture. Être cultivé ne prémunit pas contre les réactions les plus basiques. Lire des livres ne vaccine pas contre la fermeture d’esprit. Rappelons-nous que le NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands) d’Adolf Hitler a gagné en premier lieu les élections au sein de l’université.
« Les intellectuels français se sont fait détrôner par les supporters de foot allemands qui, dans tous les stades, ont déployé leurs banderoles : Refugees Welcome. »
J.-F. R. : Comment osent-ils refuser d’accueillir des migrants dans la détresse la plus totale, au nom de la France, pays du droit d’asile ?
R. G. : En France, nous avons toujours eu de grands esprits qui ont rejeté les acquis révolutionnaires, la philosophie de Montaigne et de Voltaire. Pour autant, ils étaient face à une domination numérique et talentueuse d’intellectuels. Aujourd’hui, ce qui m’interpelle, plus que ce discours de fermeture, c’est le silence de ses opposants. Un fait marquant : à la fin de l’été 2015, les intellectuels français, a priori symboles de l’ouverture d’esprit, se sont fait détrôner par les supporters de football allemands qui, dans tous les stades, ont déployé leurs banderoles : “Refugees Welcome”. Au même moment en France, on entendait les discours que vous évoquiez. Nous sommes un peuple fasciné par l’aventure. Nos héros, Bougainville au XVIIIe, Tabarly au XXe, représentent cette soif de découverte et pourtant, aujourd’hui, nous sommes tournés vers notre nombril et les frontières françaises mythiques. Jusque dans les années 1980, tous les intellectuels français étaient débattus dans les universités américaines, aujourd’hui pas un seul n’est traduit. La France parlait au monde et écoutait le monde, Paris était un lieu où se discutaient des idées qui rayonnaient. Le débat n’existe plus.
J.-F. R. : Plus concrètement sur la Syrie, que peut-on faire pour influencer la situation, en dehors d’exprimer ses convictions ?
R. G. : L’urgence est de ne pas laisser la moitié de notre classe politique être indifférente voire approuver, comme Marine Le Pen, l’action de Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. Le terrorisme est tellement abject, tellement “terrorisant”, que nous pouvons rentrer dans une logique binaire. Voilà le piège ultime qui peut entraî- ner un changement de paradigme. Sur cette question, François Hollande a eu des positions justes et dignes, notamment face à la Russie, malheureusement il les exprime de manière faible. Cela souligne le fait que le président de la République a des principes mais est incapable d’aller au bout. Il a géré de la même manière le service civil mis en place pour remplacer le service militaire obligatoire – jusqu’alors le seul moyen de faire se rencontrer des jeunes nés à Trappes, en Alsace et dans le 7e arrondissement de Paris. Or, en optant pour le volontariat, il a anéanti toute chance que ce brassage culturel, pourtant essentiel, existe. C’était le seul moyen pour ces jeunes de découvrir ce qu’ils ont en commun : la République. Voilà l’incarnation même de l’empêchement. Nous n’allons jamais au bout de nos principes qui, pourtant, ont fait la France. Désinhibons-nous ! Quand nous avons une idée, défendons-la jusqu’au bout !

J.-F. R. : Comment analysez-vous la réaction des pays de l’Union européenne face à la crise des migrants ?
R. G. : La solidité de l’Union européenne a été testée une première fois avec la crise économique en Grèce, mais surtout avec la crise des migrants. Ce qui m’a frappé, c’est la manière dont l’Allemagne s’est retrouvée isolée lorsque Mme Merkel a proposé d’accueillir les réfugiés. Seule la Suède a suivi. Le reste des pays européens soit regardaient par terre, comme la France, soit étaient vent debout, comme la Hongrie et la Pologne. À Calais, j’ai pu constater la manière dont la France traitait la situation. J’ai assisté à une République qui perd pied et laisse s’établir un bidonville infect sur notre territoire avec des enfants qui survivent dans la boue, sans autre aide de l’État qu’une présence policière pour les empêcher de sortir. Cette crise était une forme de crash test de la solidité européenne. Il n’y a eu aucune solidarité, aucune réponse commune. Chez les citoyens européens, cela se traduit par un déficit de sentiment d’appartenance, ne serait-ce que dans le rapport au drapeau européen. Regardez ce qui s’est passé en Ukraine lors de la révolution orange de 2014 : des jeunes sont morts avec ce drapeau entre les mains, morts pour les valeurs qu’il porte. Quel dirigeant de l’UE a fait un discours sur ce moment pourtant potentiellement crucial pour l’Europe ? Pas un.
J.-F. R. : N’avez-vous jamais imaginé vous associer avec d’autres intellectuels européens, et recréer le débat en martelant ces principes ?
R. G. : Je constate effectivement que le débat intellectuel européen était beaucoup mieux fédéré au XVIIIe siècle. Voltaire, lorsqu’il s’établit à Ferney, crée “une auberge pour l’Europe” où transiteront les intellectuels de différents pays formant la République européenne des lettres. Dans l’Union européenne actuelle, les sphères sont beaucoup plus nationales. C’est le paradoxe ultime de ce projet européen, et il le paye. L’Union européenne s’est construite théocratiquement, institutionnellement, économiquement mais pas sur les plans intellectuel et politique, voilà sa faille. Avoir une monnaie et des règles communes ne crée pas l’union, ce sont les idées qui créent un ensemble. La responsabilité revient aux dirigeants, qui ont dépolitisé, désidéologisé, et aux gens de culture, qui ne se sont pas organisés. Je pense que c’est la mission absolue de ma génération, sinon l’Union européenne va clairement disparaître.
J.-F. R. : Que faut-il penser de ces replis nationalistes à travers le monde ?
R. G. : Cette “idéologie des murs”, qui va de Moscou à Washington et balaye l’Europe d’un vent de populisme, marque un moment crucial. Bien sûr, il existe des liens de causalité entre ces sursauts nationaux. Le terrorisme en est un, il renforce la tendance au repli. Dans cette logique, construire des murs autour de l’Europe ne suffira pas, il faudra bientôt en dresser entre les pays européens et, pour finir, entre les quartiers. On en revient à l’image décrite par Vaclav Havel : la suppression des ponts au profit de barbelés. Nous sommes à un moment charnière, car il faut bien voir que cela changera également le mode d’existence de ceux qui vivent à l’intérieur de ces murs ! Il ne s’agit pas de supprimer le contrôle aux frontières de l’Union européenne, mais je pense que ce choix nous définit en tant que citoyen. Si aujourd’hui nous sommes prêts à dresser des murs contre des gens qui meurent en Méditerranée et à rétablir les frontières à l’intérieur de l’Europe, cela détermine le type de sociétés dans lesquelles nous vivrons demain.
« Mon père avait transformé son appartement en ambassade de l’humanité. J’ai ainsi eu la chance, dès mon enfance, de voyager sans même quitter mon salon et de découvrir que l’autre est à la fois différent et semblable. »
J.-F. R. : Parlez-nous de vos voyages, en Ukraine, en Géorgie. Que vous ont-ils apporté ?
R. G. : J’ai eu une chance extraordinaire dans l’existence, pour laquelle je dois un remerciement éternel à mes parents. Lorsque j’étais petit, le monde venait chez moi. Je laissais ma chambre à des Afghans, des Chiliens, des Tchèques, dissidents de passage à Paris. Mon père avait transformé son appartement en ambassade de l’humanité. Comme n’importe quel enfant, j’étais fâché de laisser ma chambre mais j’assistais à des dîners où des anticommunistes de l’Europe de l’Est s’entendaient parfaitement avec des antifascistes d’Amérique du Sud. Finalement, ils partageaient la même vision du monde, une vision de liberté. J’ai ainsi eu la chance, dès mon enfance, de voyager sans même quitter mon salon et de découvrir que l’autre est à la fois différent et semblable. Depuis, j’ai gardé ce culte du moment où l’on arrive à l’étranger et où l’on perd ses repères, il faut alors se débrouiller. Ainsi, en 2001, étudiant à Sciences-Po, j’ai décidé de partir pour un semestre à Alger. J’étais le premier stagiaire français de la presse algérienne francophone à rejoindre le journal Le Soir d’Algérie. Finalement je suis resté un an. Ensuite je suis parti au Rwanda pour un projet de documentaire, puis dans les pays d’Europe de l’Est lors des révolutions de couleur. J’ai ainsi été témoin de cette jeunesse qui décidait de se structurer politiquement et de changer son monde. Là, à Tbilissi en Géorgie ou à Kiev en Ukraine, j’avais l’impression de vivre en direct ces mouvements d’irruption de vie, lus dans les livres d’histoire de France, lors desquels la politique devient essentielle et la jeunesse prend le pouvoir. Paradoxalement, je me sentais alors plus français que si j’étais resté en France. Ainsi, j’ai découvert à travers ces différents voyages, du Maghreb à l’Europe de l’Est, un véritable espace culturel commun.
J.-F. R. : Votre prochain voyage ?
R. G. : Je vais continuer à traverser la France et m’installer dans des endroits que l’on a tendance à oublier : les zones périurbaines. J’y ai déjà passé pas mal de temps, en Picardie notamment, à écouter les gens. Il y a dans le triomphe actuel de l’idéologie réactionnaire et du Front national une grande part de responsabilité des élites soi-disant progressistes et humanistes dans leur incapacité à entendre la souffrance d’une partie de la France. La majorité des gens qui épousent la cause du repli sont d’abord en demande d’écoute. C’est quelque chose d’essentiel. La simple injonction morale venant de Paris ne fonctionnera pas. Il faut partir de ces zones culturellement isolées, socialement déclassées et économiquement mal en point, et comprendre pourquoi en France cela se traduit par le vote Front national alors qu’en Espagne, par exemple, cela donne naissance à des mouvements de renouvellement comme Podemos et Ciudadanos.
J.-F. R. : À travers vos voyages, avez-vous perçu des idées dont la France devrait s’inspirer ?
R. G. : Évidemment. Prenez le débat sur l’école. Tout le monde reconnaît les lacunes du système français, et parmi les causes certains dénoncent l’influence soixante-huitarde. Ceux-là n’ont jamais mis les pieds dans une école allemande ou finlandaise. Dans ces pays voisins, les structures sont beaucoup plus horizontales, axées sur le dialogue, moins rigides avec les élèves et cela fonctionne ! Or en France tout le monde pense qu’il faut revenir à la blouse et aux coups de règle. C’est encore une fois le symbole du repli sur soi. Vous savez, le principe de la philosophie selon Aristote, c’est l’étonnement. Rencontrer l’autre et s’effacer pour l’appréhender, c’est à partir de là que l’on peut construire une pensée. Aujourd’hui, on a perdu toute capacité à s’étonner, de la même manière qu’on a oublié ce qu’est l’empathie. À Calais, j’étais sidéré de voir parmi les bénévoles des Belges, des Anglais mais très peu de Français. Nous avons pris l’habitude de critiquer avant tout. Or, je ne pense pas que la retraitée munichoise qui prépare une soupe pour les migrants voie derrière cette situation d’accueil un calcul de l’État allemand pour obtenir de la main-d’œuvre pas chère. En France, nous ne savons plus être simples. C’est pourtant l’aboutissement de la pensée, rester naïf. Malgré tout, les mouvements associatifs se développent, il faut simplement briser l’inhibition à afficher son altruisme.
Interview
JEAN-FRANÇOIS RIAL
Photographies
FREDERIC STUCIN