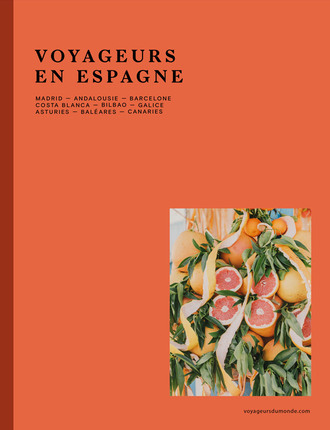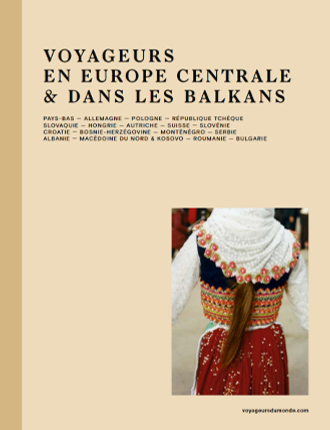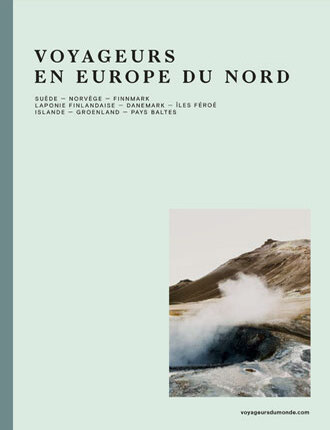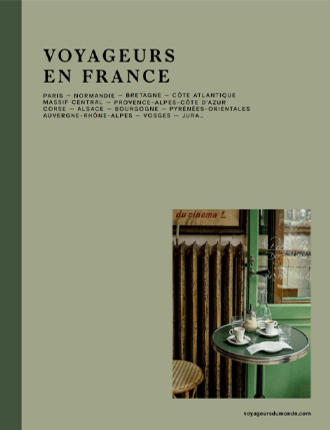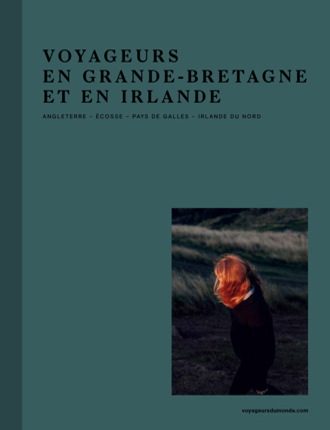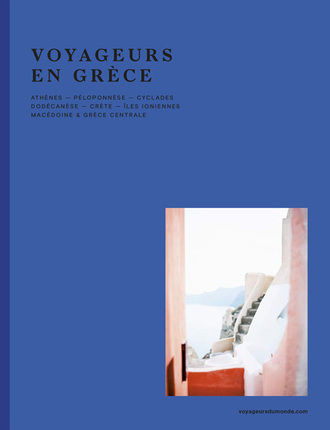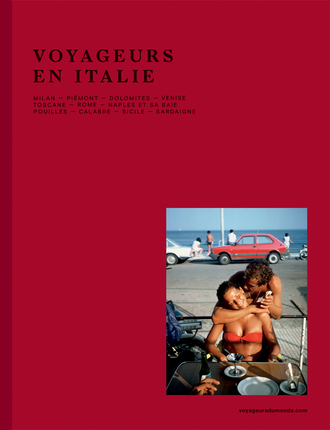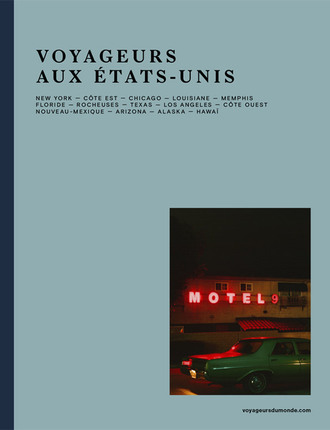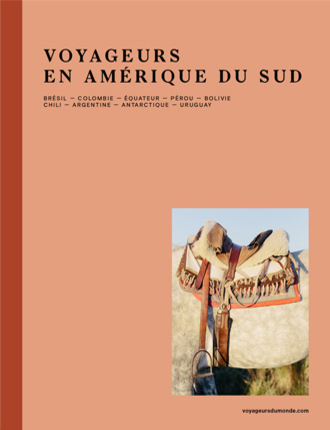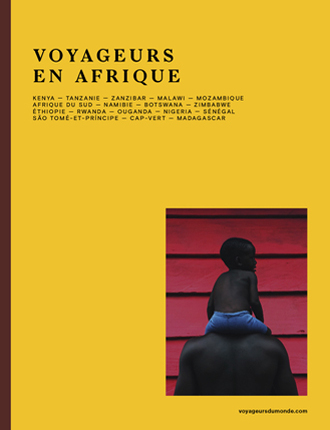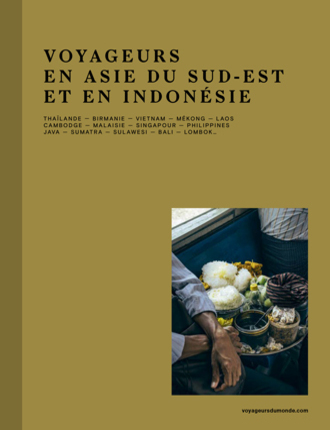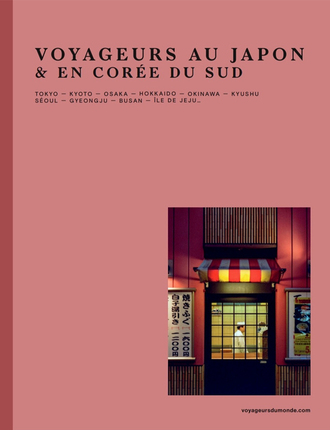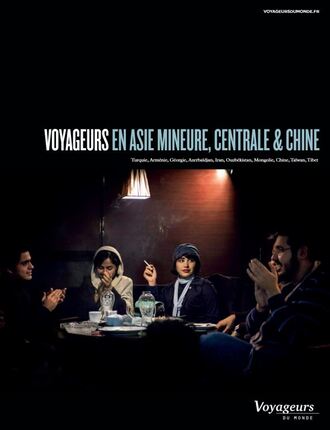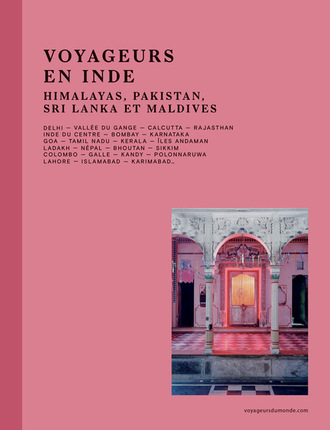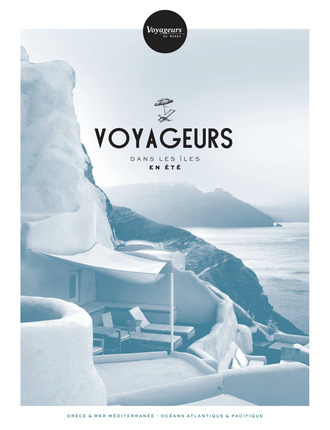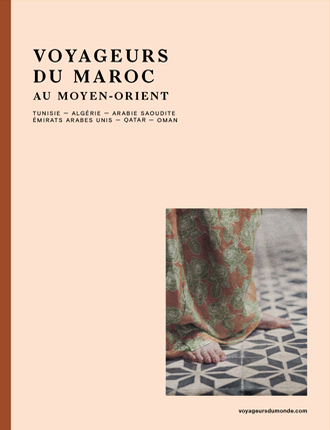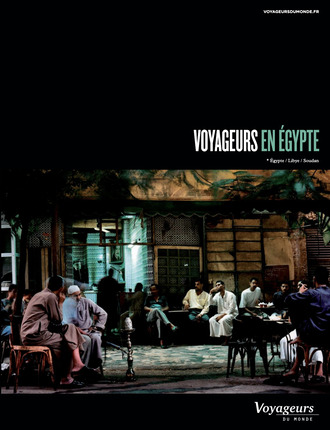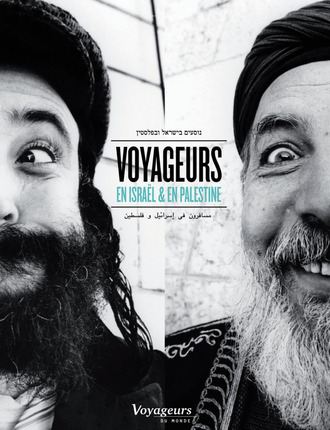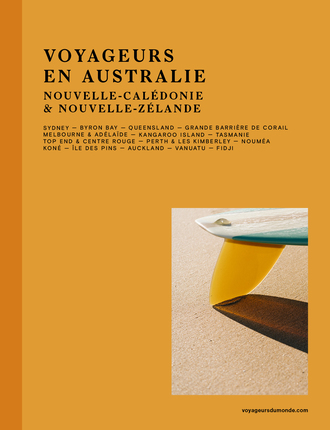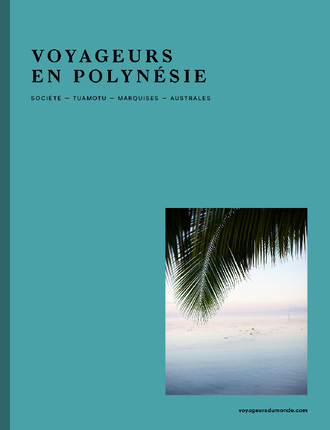Population
12 350 179, en 2024.
Langue officielle
Arabe classique.
Langues parlées
L’arabe classique n’est la langue maternelle d’aucun Tunisien. Celle-ci est l’arabe dialectal tunisien dans plus de 90% des cas. L’arabe classique, appris à l’école, est réservé à des situations formelles et à l’expression écrite. On le pratique plus ou moins selon son degré d’éducation ; dans les médias, il prend la forme de l’arabe standard. Pour résumer la situation de bien des Tunisiens, ils parlent une langue qu’ils n’écrivent pas et écrivent une langue qu’ils ne parlent pas. L’arabe dialectal a aussi ses particularités locales, qui ne brouillent pas les communications. Les pas 10% restants (qui parlent eux aussi tunsi dans la vie courante) ont pour langue maternelle un autre arabe dialectal (algérien, libyen, djerbi, etc.) ou une langue berbère (chaouia, nafusi, ghadamès). Le berbère / amazigh ne bénéficie d’aucune mesure de soutien de la part des autorités. On estime à 30% le nombre de Tunisiens réellement francophones. Le français est, à l’instar de l’arabe classique, un indice d’éducation (ou d’activité commerciale) ; il est aussi encore la langue des affaires et des contacts internationaux. Cependant, l’anglais lui fait désormais une concurrence sérieuse.
Peuples
Des populations variées ont traversé l’histoire tunisienne. Aujourd’hui, pour la plupart, les Tunisiens sont d’origine arabe et de culture cosmopolite. En ce qui concerne les Berbères, la question est close pour les autorités : ils sont assimilés. Néanmoins, selon les estimations, ils seraient entre 1% et 10%, dispersés dans le sud et l’ouest, les villes. À ce qui semble le terme d’une très longue histoire, les juifs tunisiens ne sont plus qu’environ mille cinq cents.
Religions
L’islam sunnite est religion d’État (article 1 de la Constitution). Les Tunisiens sont très majoritairement de tradition malikite (85%, pour 15% de tenants du hanafisme). La mosquée Oqba Ibn Nafi de Kairouan est la première fondation de ce type au Maghreb, VIIe siècle. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Les chrétiens sont ultra minoritaires ; néanmoins, l’église catholique joue encore un certain rôle institutionnel et culturel ; les mouvements évangéliques sont présents sans tambours ni trompettes. Sept synagogues rassemblent encore les juifs tunisois. Il y a une yeshiva dans la capitale et une autre à Djerba ; sur cette île, la synagogue de la Ghriba réunit des milliers de personnes à l’occasion d’un pèlerinage annuel.
Fête nationale
25 juillet : anniversaire de la proclamation de la République, en 1957.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
20 mars : fête de l’Indépendance.
9 avril : jour des Martyrs.
1er mai : fête du Travail.
25 juillet : fête nationale.
13 août : jour de la Femme.
15 octobre : fête de l’Évacuation.
17 décembre : fête de la Révolution.
L’islam procure aux Tunisiens des fêtes majeures : Aïd al-Fitr (fin du ramadan) ; Aïd al-Adha (fête du sacrifice) ; Ras el Am el Hijri (nouvel an hégirien, lunaire) ; Mouled (anniversaire du Prophète) ; Achoura (qui commémore la traversée de la mer Rouge par Moïse). Elles sont mobiles par rapport au calendrier grégorien.
Politique
La vie politique et institutionnelle de la République tunisienne est réglée par la constitution de 2022. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il dispose de prérogatives dans les domaines de la sécurité intérieure, de la défense et des relations internationales. Il promulgue ou fait réviser par le parlement les lois élaborées par celui-ci. Il nomme le premier ministre (majorité parlementaire), lequel compose le gouvernement et préside le conseil des ministres. Le chef du gouvernement contribue à définir la politique générale de l’État. La pouvoir législatif est dévolu au parlement. L’Assemblée des représentants du Peuple en est la chambre basse (161 membres, élus pour cinq ans) ; le Conseil national des Régions et des Districts la chambre haute (77 membres, élus pour cinq ans). Budget de l’État et plans de développement sont particulièrement du ressort du second. Une Cour constitutionnelle veille à la constitutionnalité des lois. L’autonomie du pouvoir judiciaire est postulée par la Constitution.
Histoire
Les Phéniciens fondateurs de Carthage n’ont pas tout apporté à l’actuelle Tunisie ; ils y ont rencontré des populations libyco-berbères qui avaient développé économie, organisation sociale, culture. Ils n’ont pas non plus été les seuls étrangers à débarquer. Les Grecs passaient par là. Comme en témoigne, par exemple, l’Odyssée dans l’épisode des Lotophages, qui voit l’équipage d’Ulysse enivré par les mangeurs de jujubes lotus des côtes tunisiennes. Les Phéniciens ont apporté à ces contrées l’espace méditerranéen. Ce qui n’est pas rien. Et un type de présence que leurs successeurs adopteront longtemps. Bref, en 814 avant J.-C., Carthage est fondée. La civilisation punique se développe et s’étend, avec comme système nerveux les routes commerciales. La riche production céréalière de la vallée de la Medjerda est un atout que Rome lui envie rapidement. Et puis, la thalassocratie punique se montre entreprenante en Méditerranée. Rome et elle en viennent aux mains : delenda est Carthago. Trois guerres puniques plus tard, c’est chose faite. En 146 avant J.-C., Carthage est rasée.
Le vainqueur s’installe sur les ruines – Colonia Julia Carthago – et remet le port en activité à son profit. Les bateaux appareillent, chargés de céréales et d’huile d’olive. On exploite à Chemtou un marbre doré réservé aux édifices impériaux. Les fondations romaines quadrillent le territoire. La prospérité entretient une civilisation brillante. La virtuosité des mosaïstes enchante encore aujourd’hui. Le IIe et le début du IIIe siècle après J.-C. sont l’âge d’or de l’Afrique romaine. La Provincia Africa Proconsularis existe jusqu’au Ve siècle. Les routes du business favorisent les transferts. Religieux, entre autres. Les communautés juives sont anciennes. Et le christianisme prend un essor précoce dans la province. En dépit des difficultés initiales, son développement est vigoureux. L’officialisation du IVe siècle lui est, bien sûr, favorable. Il est porté par des personnalités fortes, comme Cyprien de Carthage, Tertullien ou Augustin d’Hippone. Néanmoins, la crise donatiste interroge l’équilibre entre l’Empire et l’Église. Tentation africaine dans une Église jusqu’alors fermement romaine ? Quoi qu’il en soit, le donatisme est condamné. Après une hérésie, une autre. Au Ve siècle, les Vandales s’emparent de la province. Ils professent l’arianisme. Pendant une centaine d’années, il faut faire avec. Puis vient Byzance, qui déporte les Vandales et installe un exarchat. Le débat théologique du moment s’intitule monothélisme, il porte sur la volonté du Christ. Par la fiscalité et l’éloignement, Constantinople s’aliène l’Afrique. Carthage se rétracte.
Au VIIe siècle, le dynamisme est arabo-musulman. En 670, après quelques coups de semonce, Oqba Ibn Nafi al-Fihri bouscule les Byzantins et fonde Kairouan. En 698, Carthage est conquise par Hassan Ibn Numan. Prélude à un lent, mais décisif, processus d’islamisation et d’arabisation du Maghreb. Fin de l’ère carthaginoise, la ville étant peu à peu abandonnée au profit de Tunis. Les Omeyyades ont d’abord la main ; puis les Abbassides. D’un point de vue religieux, les choses tanguent jusqu’à ce qu’une régularité sunnite soit mise en place. La politique en Ifriqiya va être longtemps polarisée par les événements survenant en Orient et dans la péninsule ibérique. Ainsi les Aghlabides sont-ils installés par les Abbassides. Ils font de Kairouan un centre religieux et intellectuel important (sans omettre de se montrer excellents hydrauliciens). Et dotent leurs possessions de défenses solides. Pourtant, les Aghlabides sont remplacés par les Fatimides chiites. Et, lorsque ceux-ci s’en vont fonder Le Caire, ils laissent les manettes aux Zirides. Lesquels rompent avec leur patron dans le courant du XIe siècle. Piqués au vif par cette trahison, les Fatimides envoient les Hilaliens en Ifriqiya. Ces nomades arabes bousculent tout l’édifice ziride et nord-africain. Villes et campagnes vont avoir à compter avec eux. L’économie chancelle. Le pouvoir se morcelle. Les solidarités locales l’emportent un peu partout. Au cours du XIIe siècle, les Normands de Sicile s’enhardissent. Quelques lustres, ils tiennent Djerba, Mahdia, Sousse, Sfax. Puis les Almohades les repoussent.
XIIe-XIIIe siècles, la période almohade est faste pour l’Afrique du Nord. En 1207, les clés de l’Ifriqiya sont confiées à Abû Muhammad Abd al-Wâhid ben Abî Hafs. Une vingtaine d’années plus tard, son fils, Abû Zakariyâ Yahyâ, dénonce ses obligations envers le califat réformateur. La dynastie Hafside établit sa capitale à Tunis. Elle va – sans génie, mais avec opportunisme – diriger le pays jusqu’au XVIe siècle. En 1270, saint Louis, au cours d’une croisade peut-être fourvoyée, vient mourir à Carthage. Au XIVe siècle, une atmosphère de déclin s’installe. La peste accentue le problème démographique. L’économie marque le pas. L’Europe chrétienne monte en puissance. La pression espagnole s’accentue. Le royaume de Grenade s’effondre au XVe siècle. Les Hafsides ont un problème. Afin de le résoudre, ils font appel à des corsaires ottomans, les frères Barberousse. Lesquels s’illustrent sur les côtes maghrébines. La bagarre entre l’Espagne et l’Empire ottoman s’intensifie en Méditerranée occidentale. En 1535, Charles Quint chasse Khayr ad-Din Barberousse de Tunis, dont celui-ci s’était emparé l’année précédente. Le Hafside passe sous la tutelle du Habsbourg. Les Ottomans reviennent en 1574 et font de la Tunisie une province de leur empire, la régence de Tunis. Ce que reconnaît bientôt Philippe II. La piraterie barbaresque a de beaux jours devant elle.
Le pacha ottoman ne tient pas grand-chose en dehors de Tunis et des ports. Les pouvoirs locaux font la pluie et le beau temps partout ailleurs. La conquête administrative ne sera achevée qu’au début du XIXe siècle. En attendant, les janissaires de Tunis imposent un dey et un bey, cheville ouvrière de la régence. Le lien avec Istanbul est purement nominal ; du coup, la course en mer fournit aux finances. Le XVIIe siècle et le suivant passent ainsi. Le bey Hussein Ben Ali fonde une nouvelle dynastie Husseinite en 1705. Exit la régence. L’autonomie de la Tunisie se renforce encore. En 1831, un drapeau est adopté. L’esclavage est aboli en 1846. Et la première constitution arabe voit le jour en 1861. Le pays s’ouvre à une certaine modernité. Las ! Les comptes sont dans le rouge. La fiscalité harasse la population, qui se révolte en 1864. La constitution aura duré trois ans. Avec la banqueroute, les puissances européennes s’invitent en Tunisie. Le pays n’a pas les moyens d’une indépendance qui paraissait pourtant à portée de main.
Pour intervenir à Tunis, la France et l’Italie sont sur les rangs. Cependant, ce sont les vrais costauds, Grande-Bretagne et Allemagne, qui décident. En marge du congrès des Nations de 1878, le prétendant français est agréé. Il ne faut pas un mois en 1881 pour imposer le protectorat à Mohammed el-Sadik Bey. Complément à ce traité du Bardo, les conventions de La Marsa de 1883 mettent la Tunisie sous tutelle. Le résident général a la haute main sur les affaires. Un régime de type colonial est mis en place. Infrastructure, développement agricole, exploitation minière, éducation à l’européenne mais inégalité structurelle s’ensuivent. Le mouvement national tunisien apparaît avec le XXe siècle : Jeunes Tunisiens, 1907. La création en 1920 du Destour, Parti libéral constitutionnel, est décisive. L’un de ses membres, l’avocat Habib Bourguiba, défend une ligne nationale et laïque. Ce qui l’amène à fonder, après une scission du parti, le Néo-Destour. Cette mouvance défend une approche politique. Des pourparlers avec le Front populaire échouent et voilà Bourguiba (avec d’autres) condamné pour cinq ans à la suite des évènements du 9 avril 1938. Le Néo-Destour entre dans la clandestinité. Pendant la guerre, Bourguiba se range du côté des Alliés. Au terme de la campagne de Tunisie, à laquelle ont participé Américains, Britanniques et Français (Armée d’Afrique et Forces françaises libres), l’Afrikakorps est chassée d’Afrique du Nord. Bourguiba est libéré. Farhat Hached fonde l’importante Union générale tunisienne du travail, qui relaie efficacement les thèmes nationaux.
Suivent dix années d’une situation mouvante, marquée par l’échec des négociations entre les autorités françaises et les responsables tunisiens. La spirale de la violence est amorcée. La situation menace d’échapper aux différents protagonistes mais, en 1954, l’autonomie interne de la Tunisie est reconnue par le président du conseil Pierre Mendes France. Et, un an et demi plus tard, le 20 mars 1956, c’est l’indépendance. Constituante, entrée à l’Organisation des Nations unies, proclamation de la République. Bourguiba président. Le Néo-Destour, rebaptisé Parti socialiste destourien, est hégémonique. Une expérience socialiste menée par le premier ministre Ahmed Ben Salah tourne court. Coup de barre, l’économie est libéralisée ; l’État demeurant sur la dunette. Pour la société tunisienne, la période est contrastée. Le statut des femmes évolue. 1975, Bourguiba président à vie. Les revendications des Tunisiens se heurtent à une certaine sclérose du pouvoir. L’UGTT est malmenée. Et la situation économique s’enlise. Atmosphère tendue de fin de règne, qui va mettre aux prises Zine el-Abidine Ben Ali et les islamistes du mouvement de la Renaissance, Ennahdha.
L’économie est rebootée. Les islamistes sont jugulés. À partir de 1989, Ben Ali vole de succès en succès (électoraux). Les élections n’illustrant bientôt plus que le contrôle qu’il a des leviers du pouvoir. L’économie patine. La société tunisienne, comprimée, monte en pression. Les oppositions prennent langue. À partir du 18 décembre 2010, le pays entre en révolution. Le régime est emporté. Fin 2011, une assemblée constituante est élue. Et une coalition réunissant Ennahdha, le Congrès pour la République (gauche nationaliste) et Ettakatol (social-démocrate) accède au pouvoir. Crises politiques et sécuritaires caractérisent cette phase, interrompue en 2013. Un gouvernement moins marqué prenant la suite. La violence ne cesse pas pour autant. Ennahdha concentre les rancœurs. Lorsque Mohamed Morsi tombe en Égypte, le parti lâche du lest. L’UGTT promeut alors un dialogue national destiné à remettre sur le métier le projet constitutionnel. Un gouvernement technique est mis en place. Début 2014, le texte constitutionnel est prêt. Aux législatives de novembre, le parti Nidaa Tounes de Béji Caïd Essebsi devance Ennahdha en net recul. Essebsi est porté au pouvoir par l’assemblée. Le processus vaut le prix Nobel de la paix 2015 au quartet du dialogue national. Cette réussite institutionnelle ne met cependant pas un terme aux turbulences.
Personnalités
Tertullien, 160-220. Pur produit de Carthage romaine, Quintus Septimus Florens Tertullianus fut un combattant. Il mit sont tempérament emporté au service du Christ et de la Trinité. Ce qui en fait le père de la théologie latine. Après avoir pourfendu le paganisme et le marcionisme, il devait se fourvoyer dans l’hérésie montaniste. L’Église ne lui en tiendrait pas trop rigueur.
Ibn Khaldun, 1332-1406. Abdallah Laroui, le grand historien du Maghreb, suggère que, si l’œuvre de cet intellectuel et homme d’État ne permet pas d’expliquer l’histoire de son temps, cette histoire permet tout à fait d’expliquer l’œuvre. Ainsi, un certain pessimisme désabusé s’entend-il. Néanmoins, la mélancolie n’a pas désarmé le génie d’Ibn Khaldun, qui est considéré comme l’un des pères de la sociologie.
Mohamed Nakhli, 1869-1924. Professeur à l’université Zitouna et à la médersa Al Khaldounia, Mohamed Nakhli illustre la tradition réformiste moderne de l’islam. Une vie de recherche et d’enseignement, fondée sur un postulat de compatibilité de la raison et de la religion. Il ne fut certes pas le premier à défendre ce point de vue, mais son influence en fait un personnage-clé.
Gisèle Halimi, 1927-2020. Elle est née à La Goulette. Avocate, elle fut une figure du féminisme et de la gauche française, proche de Simone de Beauvoir et de François Mitterrand. De la guerre d’Algérie à l’altermondialisme d’ATTAC, en passant par la bataille pour l’IVG, elle a accompagné en femme battante les remuements de son siècle. Les hommages qui ont suivi son décès n’ont peut-être pas contrebalancé les injures qui ont accompagné son action.
Albert Memmi, 1920-2020. Il est né à la Hara, le quartier juif de la médina de Tunis. Son œuvre est taillée pour durer, mais son Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, qui eut les honneurs d’une préface de Jean-Paul Sartre, a mis le doigt sur une question dont on n’est pas encore sorti, ni au sud, ni au nord de la Méditerranée.
Radhia Haddad, 1922-2003. Il peut sembler naturel aujourd’hui que Radhia Haddad ait été élue députée après l’indépendance de son pays. Le Code du statut personnel avait fait bouger les lignes. Néanmoins, quel parcours du combattant pour en arriver là ! Elle fut aussi quinze ans présidente de l’Union nationale des femmes de Tunisie. Le féminisme conséquent passe forcément par l’establishment.
Habiba Ghribi, née en 1984. On peut penser que cette athlète spécialiste du 3000 mètres steeple a gagné ses médailles d’or mondiale (2011) et olympique (2012) sur tapis vert plutôt que sur tartan. Ce serait faire peu de cas du dopage ayant entraîné la disqualification de la « première ». Dans une telle situation, l’argent est d’or légitimement. C’est justice, mais la joie qu’il y a à passer la ligne first est perdue.
Anouar Brahem, né en 1957. Oudiste, formé au Conservatoire de Tunis auprès d’Ali Sriti, Anouar Brahem est une étoile du plectre. S’il possède comme peu d’autres les formes traditionnelles de la musique tunisienne, il a aussi engagé son instrument sur les voies du jazz, collaborant avec Jan Garbarek, John Surman ou Jack DeJohnette. World si on veut mais surtout imparable.
Habiba Msika, 1903-1930. Dans les années vingt, la jeune bourgeoisie tunisoise n’avait d’yeux que pour elle, la belle des belles. Ensuite, à Paris, ce furent Coco Chanel ou Pablo Picasso. Actrice et chanteuse de classe, sa fin tragique – arrosée d’essence par un ex-amant – en a fait un personnage de légende. Elle appartient à un monde disparu, auquel des couleurs passées donnent un charme étrange.
Hajer Bahouri, née en 1958. Unicité et non unicité du problème de Cauchy pour des opérateurs à symbole réel : tel est le titre de la thèse d’Hajer Bahouri. Les gens ordinaires ne comprennent pas ce sur quoi travaille cette mathématicienne, directrice de recherche au CNRS. Les gens ordinaires le regrettent, mais ils sont tout disposés à reconnaître en elle une scientifique tunisienne de premier plan.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
La Tunisie est un pays musulman et la tenue vestimentaire doit être correcte. En ville, les shorts, grands décolletés, vêtements moulants sont à proscrire pour les femmes. Les shorts sont perçus comme plutôt incongrus pour les hommes. Au Sahara, ni short, ni bermuda, prévoir pantacourt ou pantalon.
Pendant la période du ramadan, il est recommandé de ne pas manger, boire ou fumer en public durant la journée.
L’utilisation de drones est soumise à autorisation.
Cuisine
Comme toutes les cuisines, la tunisienne est faite des ressources du pays et de legs culturels divers. Ce qui lui donne un caractère nettement méditerranéen. Le blé, l’olivier, le mouton sont des productions déterminantes. Le premier est une base indispensable, qui se consomme quotidiennement sous forme de pain, de pâtes ou de semoule. Avec celle-ci, on fait notamment le couscous, plat désormais universel dont certaines variantes locales peuvent néanmoins surprendre. Ainsi le mesfouf sucré ou le couscous à l’osban, panse farcie. D’ordinaire, on y met mouton ou poulet, ou poisson – mérou notamment – sur la côte. La sauce tomate accompagne habituellement les pâtes. Et le pain, sous diverses formes, accompagne tout. Le maraîchage tunisien fournit de nombreux légumes, qui entrent dans une multitude de préparations : couscous, bien sûr, mais aussi soupes, salades, ragoûts, tajines. Les compositions d’épices sont l’alchimie des cuisinières. Quelques plats traditionnels imposent de citer la chorba, bouillon de viande ou de poisson additionné de langue d’oiseau, de persil et d’un trait de citron ; les briks sont frites avec œuf et thon ; la salade méchouia est composée de légumes grillés, ail, coriandre, citron, harissa, thon, œufs durs ; ragoût que la mloukhiya, au jute rouge, bœuf ou tripes. Les tajines tunisiens tiennent plus de la tortilla que de leurs homonymes marocains ou algériens. Pour la chakchouka, on fait revenir tomates, légumes, épices dans de l’huile d’olive et on casse là-dessus des œufs. La pâtisserie tunisienne s’est acquis une renommée qui dispense d’en faire la présentation : elle est protéiforme et virtuose. Les oranges maltaises sont l’orgueil de l’arboriculture fruitière. Avec les dattes (succulentes fourrées au beurre).
La bsissa est une préparation typiquement tunisienne, dont l’origine remonterait à l’époque romaine. On la prend au petit déjeuner, spécialement pendant le ramadan, avant d’attaquer le jour de jeûne. Il s’agit de farine d’orge ou de blé épicée et grillée, que l’on accommode de diverses façons. On l’additionne notamment de farine de pois chiches, puis on ajoute du lait, de l’eau ou de l’huile d’olive, selon qu’on la veut liquide ou solide. Il y a des versions salées, d’autres sucrées. Elle se consomme souvent avec des dattes. La bsissa a longtemps été le plat du pauvre, surtout à la campagne. Elle a aussi accompagné les voyageurs au long cours. Aujourd’hui elle fait partie du patrimoine culturel tunisien.
Street food : le fricassé ne saurait-être ignoré ; il s’agit d’une boule de pâte frite, puis farcie de pommes de terre et légumes grillés en dés, thon, olives, œuf dur, câpres et harissa. Un en-cas gouteux et efficace. Le sandwich kefteji est un autre substitut du repas en bonne et due forme. Dans une demi-baguette, on met un mélange de légumes frits avec un œuf frit aussi, huile d’olive, harissa, persil, oignon et, éventuellement, foie d’agneau. Des frites accompagnent. Ces dernières sont d’ailleurs assez ubiquitaires. Lablabi est un plat autour duquel on se réchauffe en hiver : soupe de pois chiches au cumin versée sur du pain émietté, additionnée d’huile d’olive, d’un œuf mollet, harissa, jus de citron et, dans certains cas, pied de veau. Au bord des routes, on vous grille de délicieuses côtelettes d’agneau.
Boissons
Afin de parer à toute éventualité, on évite l’eau du robinet et on opte pour l’eau minérale en bouteille (capsulée). Ou les sodas ; Boga étant la marque tunisienne phare. Les jus de fruit sont délicieux – citron, orange, fraise, grenade, pêche ou datte. Pour se désaltérer, on peut aussi avoir recours à la Celtia, la blonde locale. Le café est traditionnel à la façon turque, mais on le trouve sous toutes ses formes. Quant au thé, il est le plus souvent sucré, vert et à la menthe, avec amandes ou pignons de pin. Le thé noir est dit rouge (ce qui semble indiquer un premier fournisseur chinois). La production de la boukha, l’alcool de figue, a longtemps été l’apanage de distillateurs juifs. Dans la région de Nabeul, les vignerons vinifient très convenablement.