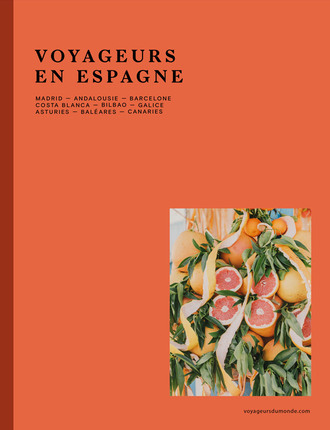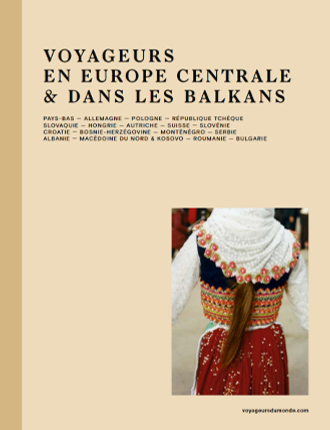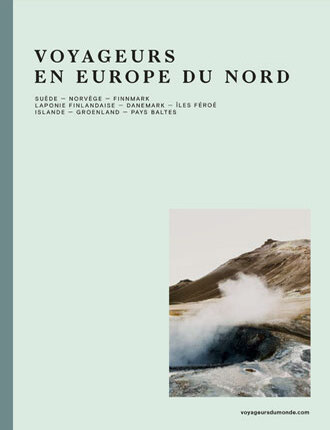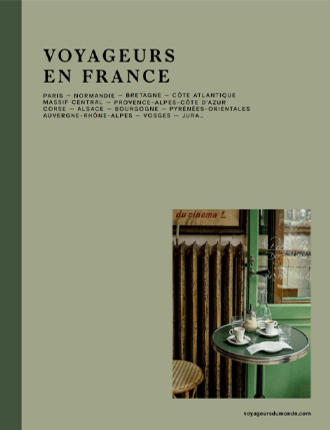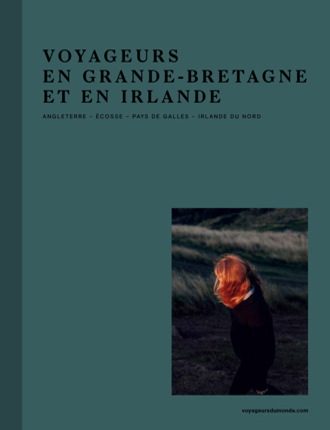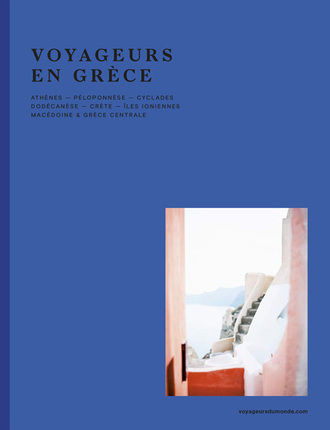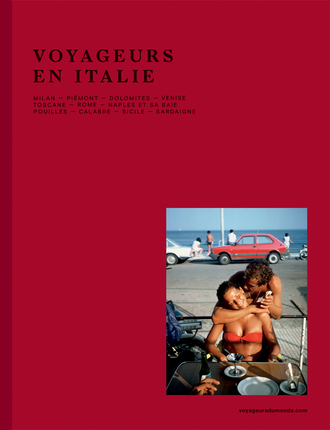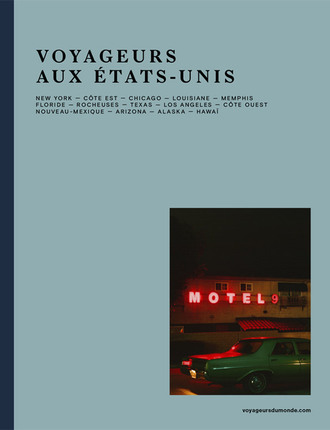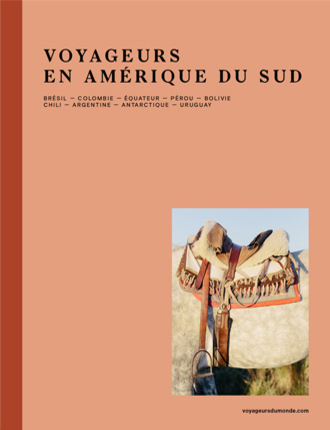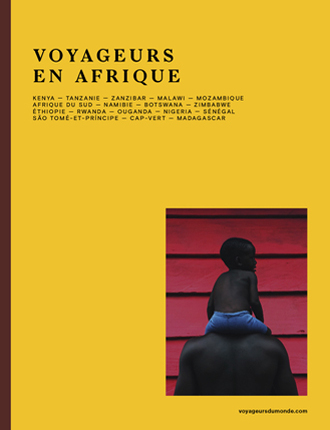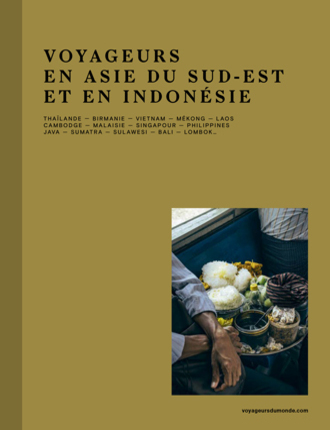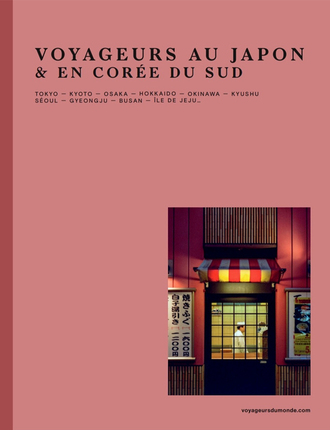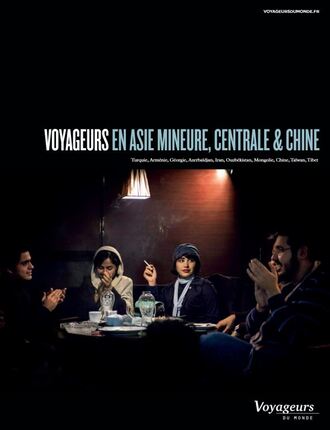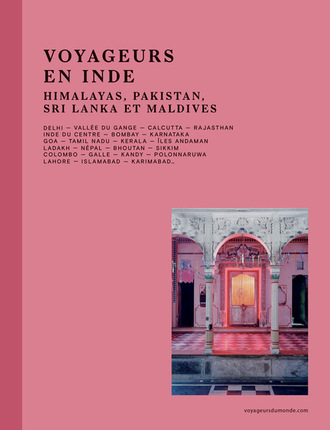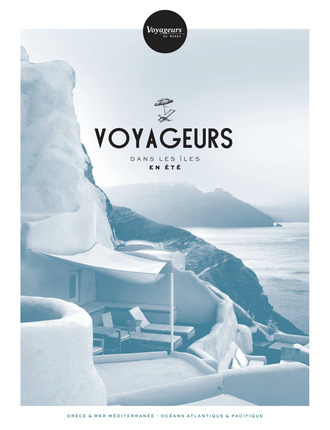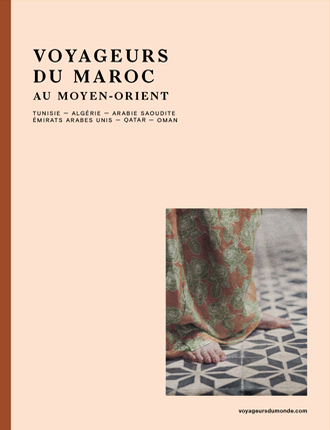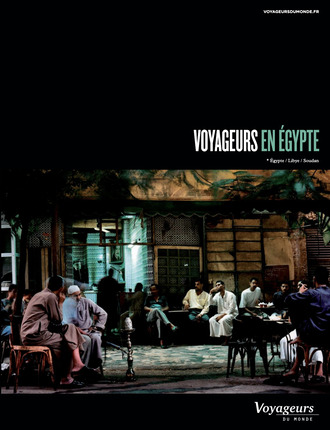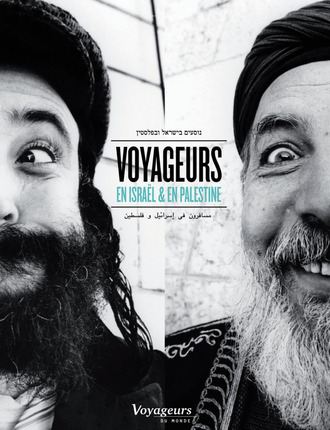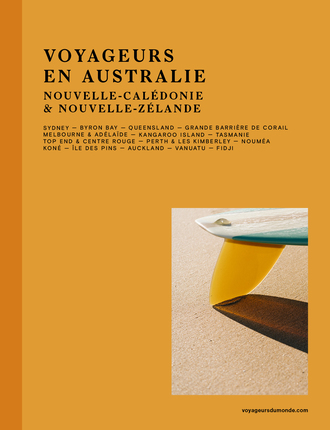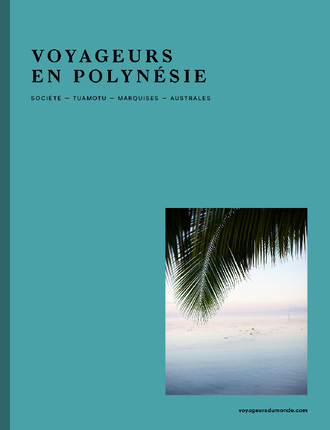Population
14 436 707, en 2025.
Langues officielles
Kinyarwanda, français, anglais et swahili.
Langues parlées
Le kinyarwanda – famille bantoue – est la langue maternelle de plus de 98% des habitants. Les nombreuses variantes dialectales sont aisément compréhensibles entre elles. Beaucoup de Rwandais parlent aussi le swahili, officialisé dans le cadre de la Communauté des États d’Afrique de l’Est ; le français, ancienne langue coloniale ; l’anglais, nouvel idiome international dominant.
Peuples
Le refus de l’ethnisme est inscrit dans la constitution de 1993. L’appartenance nationale est désormais valorisée. On se veut Rwandais avant d’être Hutu ou Tutsi ou Twa. L’homogénéité linguistique favorisant cela. On peut toutefois estimer qu’en 1996, il y avait 80% de Hutus et 19% de Tutsis ; ces chiffres sont pourtant moins absolus qu’ils en ont l’air : 25% des Rwandais ont des grands-parents hutus et tutsis. Les Twa (Pygmées), qui ont particulièrement souffert du génocide, représenteraient 0,5% de l’ensemble. On pourrait encore citer les Banyenkombo, les Bagogwe ou les Banyambo, dont l’importance numérique est faible…
Religions
93,6% des Rwandais sont chrétiens (2006) : 56,5% de catholiques et 37,1% de protestants. On notera que, depuis le génocide, les mouvements néo-évangélistes ont fait une percée remarquée. Les musulmans sont environ 4,6% (surtout à Kigali). 0,1% des habitants se réclament encore de l’animisme traditionnel.
Fête nationale
1er juillet : anniversaire de l’Indépendance, 1962.
Calendrier des fêtes
1er et 2 janvier : jour de l’an.
1er février : journée nationale des Héros.
Mars-avril : Pâques (dimanche et lundi).
7 avril : commémoration du Génocide.
1er mai : fête du Travail.
1er juillet : fête nationale.
4 juillet : jour de la Libération.
1er vendredi d’août : journée d’Umuganura (fête des moissons).
15 août : Assomption.
1er novembre : Toussaint.
25 et 26 décembre : Noël.
Politique
La vie institutionnelle du pays est réglée par la constitution de 2003. Le Rwanda est une république présidentielle. L’exécutif est dirigé par le président de la République. Élu au suffrage universel pour un
mandat de 7 ans, celui-ci dispose de pouvoirs étendus ; il nomme le premier ministre et les membres du gouvernement. Le pouvoir législatif est détenu par un parlement bicaméral : une Assemblée nationale – 80 députés, mandat de 5 ans, on notera que les femmes y sont en majorité ; un Sénat – 26 sénateurs, mandat de 8 ans. Députés et sénateurs sont élus ou nommés de telle sorte qu’aucun groupe social ne soit exclu de la représentation. La Cour suprême couronne l’édifice judiciaire, dont la base est formée par les gacaca, les tribunaux communautaires traditionnels. Le multipartisme est une réalité, même si la vie politique est dominée par le Front patriotique rwandais.
Histoire
Une approche fonctionnelle des composants sociaux rwandais a remplacé les conceptions ethnicistes : agriculteurs / hutus, éleveurs / tutsis et chasseurs-cueilleurs / twa sont les éléments interdépendants d’une même culture ; les individus passant fréquemment d’une catégorie à l’autre.
La première forme politique correspondant à la géométrie de l’actuel Rwanda apparaît au XVe siècle, sur les décombres de l’empire du Kitara. La réalité historique prend peut-être ici le pas sur la légende. Quoi qu’il en soit, tout ce qui va distinguer le Rwanda est alors réuni.
Le pays est signalé une première fois par Richard Francis Burton (1821-1890) et John Hanning Speke (1827-1864) au milieu du XIXe siècle. C’est Gustav Adolf von Götzen qui y pénètre, en 1894 ; il rencontre le mwami Kigeli IV Rwabugiri. Le Rwanda est alors un État solidement organisé en une vingtaine de clans. En 1907, les militaires allemands s’installent à Kigali, dont ils font un centre administratif, la capitale du royaume étant à Nyanza, cent kilomètres au sud. Les Belges, installés au Congo, expulsent les Allemands de leur possession en 1916. Trois ans plus tard, le traité de Versailles attribue officiellement le Rwanda à la Belgique, qui en fait (1922) un protectorat appuyé sur les pasteurs tutsis (dont l’un des clans assumait la fonction monarchique) et les pères blancs. On fait aujourd’hui grief à ces derniers d’avoir imposé à la société traditionnelle rwandaise un carcan ethnique abusif et cela au profit de la puissance coloniale. En tout cas, les missions « tiennent » l’éducation, la santé… Dans les années 50, l’idée d’indépendance vient à l’aristocratie tutsie. Sans doute cela a-t-il déterminé l’administration coloniale à revaloriser les Hutus. En 1959, une révolte hutue chasse en Ouganda le roi tutsi Kigeli V Ndahindurwa (né en 1935) et 200 000 des siens. La monarchie est abolie. Le 26 octobre 1961, la République du Rwanda élit son premier président, le Hutu Grégoire Kayibanda. La Belgique reconnaît formellement l’indépendance le 1er juillet 1962.
En 1963, des massacres de Tutsis ont lieu à la suite d’une tentative de coup de force des exilés. La situation des Tutsis restés au pays ne cesse de se dégrader. En 1973, le général hutu Juvénal Habyarimana (né en 1937) prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’État. Nouvel exil tutsi. Ceux qui restent sont toutefois réintégrés, au compte-goutte, à la vie sociale et économique. Mais leur situation, parfois prospère, est précaire ; spoliations et vexations sont monnaie courante. La dictature d’Habyarimana se met en place. L’aide au développement aussi. En 1987, Tutsis et Hutus en exil fondent le Front patriotique rwandais (FPR). Les alliés occidentaux du président le pressent de libéraliser son régime. Octobre 1990 : les forces armées du FPR pénètrent dans le nord du pays. Les militaires français et belges sécurisent Kigali. La démocratisation du régime va être disruptive. On réclame l’intégration du FPR à la vie politique nationale. En réponse, le parti présidentiel arme des milices. En 1992, l’opposition gagne les élections. Début 1993, le FPR mène d’importantes opérations militaires au Rwanda. Des pourparlers ont été engagés avec les exilés, qui aboutissent aux accords d’Arusha (août 1993), aux termes desquels l’État rwandais s’engage à intégrer les organisations FPR. Les casques bleus de l’ONU viennent remplacer les soldats français et belges. Habyarimana traine les pieds. Le 6 avril 1994, son avion est abattu.
La mort du président déclenche le génocide. Les miliciens sont lâchés. L’opération humanitaire armée Turquoise n’échappe pas au soupçon de partialité. L’abomination va durer jusqu’ à ce que le FPR prenne Kigali, le 4 juillet 1994. L’ONU estime que 800 000 personnes ont été massacrées.
Le premier président post-génocide est un Hutu, Pasteur Bizimungu (né en 1950), et son vice-président un Tutsi, Paul Kagame (né en 1957), chef du FPR. Les réfugiés rwandais ont inondé les régions frontalières (surtout au Zaïre / RDC). La question de la justice à rendre pour le génocide est épineuse. Le président zaïrois Mobutu fait les frais des soubresauts de la crise rwandaise (1997). Bizimungu démissionne en 2000, remplacé par Kagame. Trois ans plus tard, les élections présidentielles donnent à ce dernier 95% des suffrages ; dans la foulée, les législatives lui assurent une majorité parlementaire. Depuis, le pays poursuit son aggiornamento, en légiférant de façon progressiste (abolition de la peine de mort), en libérant des opposants (dont l’ancien président Bizimungu, condamné pour corruption) et en s’impliquant dans la résolution des conflits africains, au Darfour notamment. La question des responsabilités dans les évènements de 1994 empoisonne les rapports franco-rwandais. Les relations diplomatiques sont rompues en 2006, puis rétablies en 2009. Depuis, les deux pays tâtonnent sur le chemin d’une normalisation.
Personnalités
Muhumusa. Umugirwa (médium) du culte anticolonial Nyahbinghi, Muhumusa a mené un long combat contre successivement les Allemands et les Britanniques (et pour faire reconnaître son fils comme successeur de Kigeri IV Rwabugiri). L’influence qu’elle exerçait était assez mobilisatrice pour que les derniers déploient de grands moyens pour mettre la main dessus. Finalement capturée en 1911, elle est emprisonnée à Kampala jusqu’à sa mort.
Gustav Adolf von Götzen, 1866-1910. Le comte von Götzen était un uhlan un peu raide, mais un voyageur tenace. Il fut le premier Européen à traverser le Rwanda et sut nouer des relations cordiales avec le mwami Kigeri IV Rwabugiri. Plus tard, gouverneur de l’Afrique orientale allemande, il dut faire face à la révolte des Maji-Maji (1905).
Dian Fossey, 1932-1985. Elle était radicale, cassante et alcoolique, mais cela ne méritait pas les coups de machette qui mirent fin à sa carrière d’éthologue. Ses études sur les gorilles des Virunga ont assuré la notoriété et la préservation de ces primates (Gorillas in the Mist, 1983). En fait, elle empêchait surtout de braconner en rond.
Scholastique Mukasonga, née en 1956. C’est une auteure dont les textes tentent d’établir une passerelle – toujours précaire et menacée – entre les morts et les vivants, le proche et le lointain. Inyenzi ou les cafards (2006) revient sur la relégation sociale dont les Tutsis ont souffert pendant les années 60. Prix Renaudot en 2012 pour Notre-Dame du Nil.
Cornelius Nyungura, né en 1977. Corneille, est un chanteur canadien d’origine rwandaise. Sous influence soul et funk, il distille un humanisme sensible, marqué par le souvenir du génocide, au cours duquel périt sa famille. Il est respecté tant pour sa carrière que pour sa disponibilité à soutenir des causes justes.
Carole Karemera est née en 1975 à Bruxelles de parents rwandais. C’est une artiste accomplie, formée au Conservatoire royal. On la voit dans Les Troyennes d’Euripide ; dans des spectacles du metteur en scène Jacques Delcuvellerie ou du chorégraphe Wim Vandekeybus. Elle joue aussi du saxophone. Installée au Rwanda depuis 2005, elle y déploie une activité culturelle tous azimuts.
Félicité Rwemarika, née en 1958. Cette militante pour le droit des femmes est membre du Comité international olympique, où elle travaille à promouvoir l’égalité dans le sport. Ses activités de conférencière débordant d’ailleurs largement les limites du terrain. À Kigali, elle mène une action multidirectionnelle en faveur de la promotion sociale des Rwandaises.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
Pour les chauffeurs, nous vous conseillons, au minimum, l’équivalent de 5 euros par jour et par personne. Le double pour les guides.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Si le cas se présente, on évitera d’encourager la mendicité, notamment celle des enfants, en faisant des distributions « sauvages » dans la rue. Si l’on souhaite apporter son aide en fournissant du matériel scolaire, des vêtements ou des médicaments, il est préférable de les remettre au directeur de l’école, au chef du village ou au dispensaire le plus proche, qui sauront en faire bénéficier les plus démunis.
Cuisine
L’isambaza, la sardine du Tanganyika, et des tilapias (que procure le lac Kivu), le poulet, le chevreau sont incontournables, mais pas quotidiens. Avec (ou sans) : banane plantain, patate douce, manioc, pois et haricots secs, chou. Le matooke est une variété de banane plantain que l’on mange bouillie ou cuite à la vapeur ; il accompagne bien les ragoûts. L’ugali est une farine de manioc cuite à l’eau, qui constitue une base nutritionnelle régionale. Avec des feuilles de manioc, des aubergines et des épinards, on fait de l’isombe. Les haricots rouges sont sautés au piment et à l’huile de palme. Ou mijotés. Et, avec tout ce dont la chair se tient assez pour ça, on fait des frites. Parmi les condiments, le bouillon-cube et l’akabanga, une huile pimentée, sont à signaler. Les fruits se mangent plutôt au petit déjeuner. Le plat national ? L’igisafuliya, où entrent poulet ou chèvre, banane plantain, feuilles de manioc.
Street food : les tripes, zingalo, en brochette et la brochette de chèvre-frites sont des classiques.
Boissons
L’eau du robinet étant impropre à la consommation, on boit de l’eau minérale en bouteille (capsulée) ; on évite tout autant les glaçons. Les sodas sont possibles, bien sûr. Et la bière. Le brasseur Bralirwa est le plus gros employeur du pays ; il produit les marques Primus, Mutzig, Amstel. Toutefois, beaucoup de gens font leur mousse eux-mêmes, à la maison. Deux types de bière home made se distinguent : l’amarwa (ou ikigage), à base de sorgho, et l’urwagwa, à base de banane plantain. On boit aussi beaucoup de lait (très sucré). Et le café rwandais est d’excellente qualité.