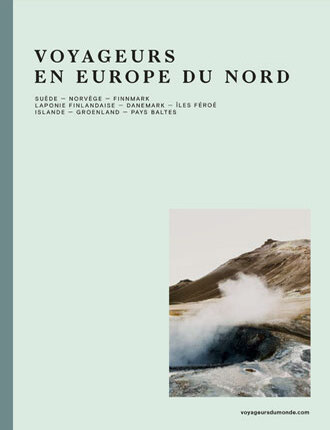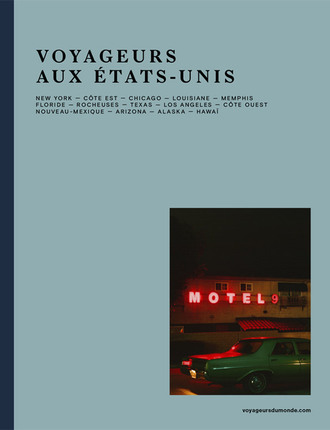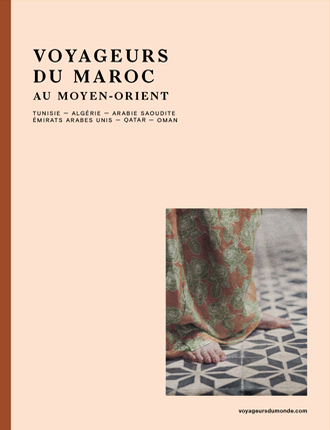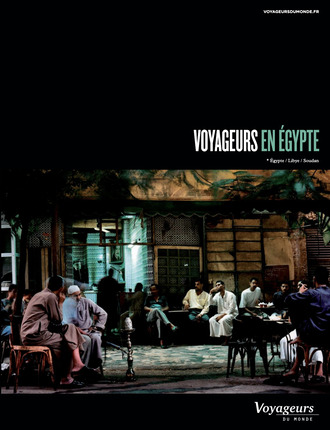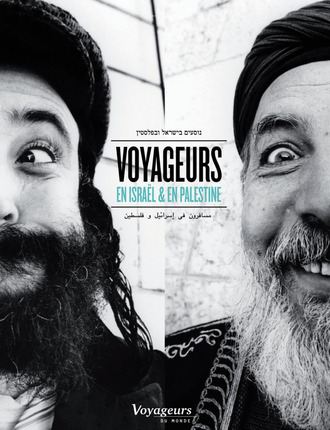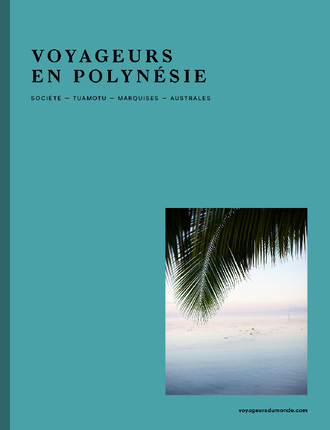Ils travaillent en harmonie avec les éléments, s’engagent à respecter sols et terroirs pour nourrir la France. Voyageurs du Monde est parti à la rencontre d’acteurs du goût qui font bouger les lignes de la production locale. Un mouvement qui se ressent jusque dans les assiettes des meilleurs restaurants. Récit d’un road trip engagé sur les traces d’un changement majeur et culturel en cours.
Le parking du port est désert. Sous la lumière automnale, des serveuses, lunettes de soleil sur le nez, rangent la terrasse d’une crêperie-bar qui semble avoir bien travaillé ce midi. Il fait chaud. Le voyageur de passage ne pourrait pas supposer qu’il y a à peine quatre jours, c’était la tempête. La mer démontée, le ciel chargé, les filets vides, les pêcheurs muets de déception. Aujourd’hui, l’horizon est d’un calme sourd. Les bateaux accostés bougent à peine. Une camionnette blanche pile sur le bitume. Sur le flanc, on peut lire “France Ikejime”.

Comme un boulet de canon, une femme, cheveux courts, sourire franc, en sort. Ses bises sont aussi énergiques que son nom : Stéphanie Woods. À la fois anglaise et finistérienne-nord, elle a adopté le Sud breton après avoir vécu huit ans au Japon et six en Nouvelle-Calédonie. “On a passé toutes nos vacances à St-Gué avec mon mari Nathan et nos enfants. Lui vient d’ici. Tous les hommes de sa famille ont toujours eu les doigts fripés par l’eau de mer.” Il semblait donc naturel qu’en revenant sur sa mer ancestrale, Nathan devienne pêcheur.

Les étocs, roches granitiques issuse de vieilles montagnes submergées, brisent l’élan des vagues avant qu’elles ne meurent sur le sable. Ils stabilisent un horizon souvent houleux. Même tempétueux, l’océan apaise, car il est grandiose. Il redonne à l’homme sa dimension juste. Stéphanie s’est laissé porter par ce sentiment afin de choisir son futur métier. Rien ne la prédestinait au mareyage, mais pour une femme pétrie de culture japonaise, l’ikejime fut la réponse. Originaire du pays du Soleil-Levant, cette technique d’abattage séculaire permettrait de respecter le bien-être des poissons au moment où ils sont pêchés et jusqu’à leur mise à mort, afin d’en préserver le goût et la texture.

Pour celle qui rêvait enfant d’être vétérinaire, travailler avec les poissons rapportés par son mari fut une évidence. Elle se forme alors sur les côtes japonaises auprès d’un maître dont elle tait le nom, se fait forger des outils à sa mesure par un artisan breton, et assoit son savoir-faire. Elle sélectionne ses pêcheurs avec soin, car le lien de confiance qui les unit lui garantit qu’ils lui proposeront les poissons les plus vifs dès le retour du large. Raies, grondins, bars, rougets…, tous les poissons sont éligibles à l’ikejime tant qu’ils tiennent dans la main de Stéphanie et qu’ils n’ont pas été abîmés lors de la prise. À terre, elle les stocke dans des viviers, triés par jour et par bateau.

Le meilleur poisson ikejime est celui qui est détendu. Pour cela, il faut attendre quelques jours de sorte que son niveau de stress redescende. L’animal recharge ainsi sa réserve d’ATP (adénosine triphosphate) qui lui permet d’avoir des réactions musculaires vives. Cet ATP se transforme en inosate une fois le poisson mort. L’inosate fait partie des composantes de l’umami, cette saveur dite délicieuse pour les Japonais. Et la mise à mort est aussi importante que la détente de l’animal.

Stéphanie prend donc elle aussi son temps, et ne passe à l’acte uniquement lorsqu’elle reçoit les commandes de ses clients. Elle enfile alors ses gants, prend la bête dans le vivier et, d’un geste rapide, le pose sur la table d’abattage. Puis, méticuleusement, elle le décérèbre avec un poinçon et lui siphonne la moelle épinière avec une sorte de câble de frein de vélo très rigide. Ainsi, l’information de la mort ne se propage pas dans les cellules du poisson – ce qui lui permet de garder sa fraîcheur plus longtemps. Pour finir, elle le saigne, afin d’éviter les mauvaises odeurs habituelles…

Les poissons ikejime peuvent maturer dans un réfrigérateur à 2 degrés durant quinze jours. Ils développeront des arômes frais et fruités (pas de “poisson qui pue” ici). Jean Rouleau, le beau-père de Stéphanie, pêcheur lui aussi, ajoute : “Par exemple, on a toujours cuisiné la raie en sauce pour cacher son goût d’ammoniaque. Mais une raie ikejime, on peut la savourer sans rien, car elle a gardé sa fraîcheur !” Les plus grands cuisiniers français ont très vite compris la valeur de ce genre de trésor. Stéphanie livre ainsi des lieux prestigieux comme le Plaza Athénée, le Clarence, le Grand Restaurant, mais aussi des adresses où l’éthique fait loi comme le Baratin et le Verre Volé. Elle donne à savourer la plénitude de son geste, de ses paysages accidentés et atemporels – un relief mouvant et paradoxalement rassurant.
Ce jour-là, les pêcheurs sont peu causants. Leur silence en dit long sur l’infructuosité de la pêche. Ils ont brûlé du fuel pour rien. La tempête a fait bouger les bancs de poissons. Pour Stéphanie, la situation n’est pas beaucoup mieux : “Mais où est-il ? Ça n’est pas possible. Il n’a pas pu disparaître comme ça. Un bar ça ne saute jamais…” Elle l’avait gardé pour nous montrer sa méthode si particulière d’abattage, mais il n’est plus dans le vivier.

Dans le hangar, au milieu de grands caissons remplis d’eau, et de tourteaux pour certains, la détresse de sa voix est atténuée par le souffle des pompes à eau. Elle cherche le bar dans les moindres recoins. Il n’est nulle part. À quatre pattes, elle éclaire le dessous des caissons, furète. Puis, d’une douceur maternelle : “Oh ! Mon chouchou ! Mais qu’est-ce que tu fais là ??!! Pourquoi t’es allé te mettre là-dessous ?” Elle saisit la perche d’une épuisette, la fait glisser sous le caisson et ramène près d’elle l’animal qui est à l’agonie. Elle est désemparée. C’est la première fois que cela lui arrive. Les viviers étaient trop pleins ce matin, elle l’avait bien vu, mais elle ne pensait pas que le bar allait se faire la malle. Précautionneuse, elle le tient de ses deux mains tendres, le remet dans l’eau sans le lâcher. Elle voudrait qu’il se ranime, et voir ses ouïes battre au rythme de sa respiration, sa bouche tétanisée par le manque d’air se détendre. Elle lui caresse le dos : “Prends ton temps, respire, respire.” Elle lui masse les bords de la bouche, le tient par la queue pour l’aider à retrouver sa flottabilité. Il semble reprendre ses esprits. Elle aussi : “C’est exactement ce que je veux leur éviter. Ça n’est pas parce que nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire que nous devons faire souffrir les animaux que l’on mange.” Sage, elle sait que sa volonté de le voir vivre ne sert à rien : “On va aller se promener sur la plage du Steir en attendant. Mais peut-être aussi qu’il y passera. Si, quand je reviens, je vois qu’il souffre, je l’abattrai pour le soulager.” Et, se tournant vers lui : “Remets-toi bien”.

Une dernière caresse, puis elle monte dans sa camionnette blanche direction l’océan. Elle y va pour marcher et respirer la bise venue rafraîchir cet après-midi houleux. L’horizon est calme. Le bar ne survivra pas. Mais il sera dégusté avec tous les honneurs. “Je mange rarement de l’ikejime, mais plutôt les poissons qui ne résistent pas. Les cordonniers sont les plus mal chaussés…” Elle repart vers la pointe de la Torche. De la fenêtre de sa camionnette, on voit la nuit tomber sur une mer immobile. Les étocs suggèrent des formes animales surgissant des eaux assombries. L’instinct de survie du bar l’aura poussé vers une mort choisie plutôt que subie. Le geste humain n’aura servi à rien. Oui, l’océan agité rend à l’homme sa juste mesure.
Par
MARIE ALINE
Photographies
JULIEN MIGNOT
> Pour aller plus loin
A (re)voir : Thalassa : au Guilvinec, le temps d’une marée